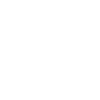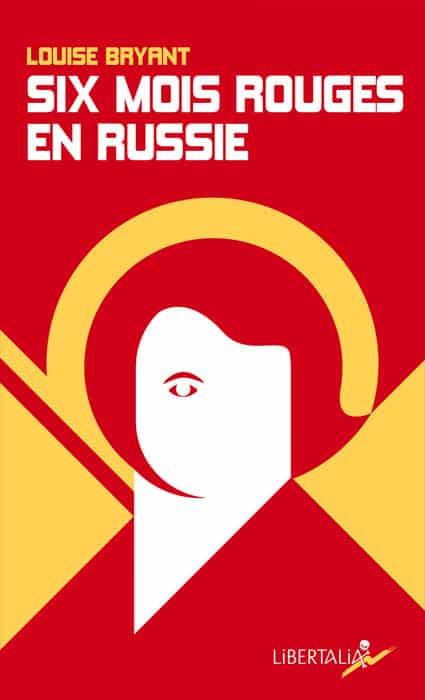Jeune journaliste américaine, Louise Bryant se rend en 1917 en Russie, peu après la révolution de février. Elle y rejoint son compagnon, John Reed, journaliste lui aussi qui passera dans la postérité pour son œuvre majeure : Dix jours qui ébranlèrent le monde (réédité dans une superbe édition augmentée par Nada). Six mois rouges en Russie raconte à son tour cet instant révolutionnaire où tout bascula pour les prolétaires, en Russie, bien entendu, mais également dans le monde entier. Mais si le sujet est le même, le livre de Bryant n’est pas un simple résumé de ce que produira quelques mois plus tard Reed. En se rendant à des endroits différents, en parcourant la Russie avec une autre temporalité et en se préoccupant de sujets distincts de son compagnon, Louise Bryant offre de nombreux articles originaux. Le livre se présente comme un recueil des textes qui parurent en 1918 dans la presse américaine.
L’arrivée de Louise Bryant en Russie révolutionnaire

Dès le départ, le ton est donné par Louise Bryant : ce livre sera un carnet de voyage d’un monde qui est en train de chavirer. Les premiers articles racontent le voyage vers Petrograd et l’arrivée en Russie révolutionnaire. Dès les premières pages, nous rencontrons aussi bien une princesse qui se voit confisquer son maquillage, des soldats épris de doute, mais qui n’ont qu’une envie : la fin de la guerre, ou encore un vieux révolutionnaire qui peut enfin rentrer chez lui et qui pense que tout est gagné. L’autrice nous surprend à nous attacher à ces personnes simples, qui sont celles qui font vivre la révolution, s’emparant de la question politique en la protégeant les armes à la main s’il le faut ou, parfois, doutant sincèrement de ce qu’ils vont advenir. Lorsque Louise Bryant arrive à Petrograd, la situation est loin d’être apaisée : des rumeurs laissaient entendre que Kerenski, alors à la tête du gouvernement provisoire, vient de se faire assassiner.
Smolny et les grandes figures de la révolution

Rapidement, nous comprenons que l’endroit où tout se passe est l’institut Smolny, cet ancien couvent qui devint après la révolution de février le quartier général du parti bolchevik. Louise Bryant nous y décrit les réunions qui ne finissaient jamais, ses rencontres avec les personnes qui comptent le plus lors de ces journées qui changèrent les rapports de forces : Lénine, bien sûr, dépeint comme relativement inaccessible, mais comme un grand théoricien de la révolution, Trotski ensuite, montré comme un remarquable orateur qui savait mobiliser les foules. Kerenski en tant que figure majeure de cette période est également présenté. Il prend place dans les chroniques comme un jeune homme dépassé par les évènements et à la traine de l’histoire. Les femmes ont également une place très importante dans cette histoire de la révolution en Russie. Nous pouvons ainsi lire un article complet sur Catherine Breshkoviski, la grand-mère anarchiste de la révolution et Maria Spiridinova, une socialiste-révolutionnaire de gauche qui contribua grandement à l’alliance entre son parti et les bolcheviks. Louise Bryant confronte également les bilans de Kollontaï et de l’ancienne ministre de l’Assistance sociale : la bourgeoise Panina . À travers ces figures nous voyons deux mondes qui s’affrontent : l’ancien, dépassé et perdu et le nouveau, révolutionnaire et triomphant.
Le peuple en marche

Mais Six mois rouges en Russie n’est pas un bottin mondain de la période révolutionnaire, Louise Bryant s’attache à raconter le peuple, véritable âme de la révolution. Là aussi, les femmes jouent un rôle prépondérant. La journaliste n’hésite pas à se rendre au Palais d’hiver alors menacé de bombardement par le croiseur Aurora pour rencontrer les femmes soldates, comprendre leurs motivations à soutenir Kerenski puis raconter leur adhésion au bolchévisme. Tout comme John Reed, elle participe à tous les moments importants de cette période : le congrès démocratique, la chute du palais d’hiver ou l’assemblée constituante. Elle rend également compte des petits moments révolutionnaires, mais qui se révèlent ô combien important : les funérailles rouges à la suite du massacre de Moscou, les habitudes des gardes rouges, le fonctionnement des tribunaux révolutionnaires ou encore la vie des enfants russes.
Le bouleversement politique
Louise Bryant n’hésite pas également à analyser la politique des bolcheviks et des autres groupes politiques. Dès le début du livre, elle nous propose un rappel des partis en présence et de ce qu’ils représentent. Puis elle revient sur les différentes politiques sociales, le déclin de l’Église alors pourtant toute puissante, la liberté d’expression et le poids des propagandes respectives des partisans de l’ordre ou de ses détracteurs. Le but est clair : nous faire adhérer à cette révolution qu’elle voit comme une libération des êtres humains, une prise du pouvoir concrète du prolétariat qui s’occupe des affaires courantes de l’État. Sans hésiter à prendre parti, elle affirme à plusieurs reprises que les Américains se doivent de soutenir la jeune république.
Une œuvre complémentaire et indispensable
Six mois rouges en Russie n’est pas seulement un récit de voyage ou un livre secondaire. C’est surtout un livre complémentaire de celui de John Reed ou celui d’Emma Goldman deux ans plus tard, exposant une autre facette de la révolution, se penchant au plus près des sujets qui l’intéressait, particulièrement la question féministe. Nous ne pouvons que nous interroger sur le temps qu’il a fallu pour qu’il soit enfin traduit en France. Les éditions Libertalia ont abattu un travail essentiel et permettent à tout un chacun de découvrir ce livre.