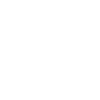Deux livres très différents à première vue qui abordent deux thèmes plutôt éloignés : la « question rom » actuellement en France et la résistance ouvrière dans une usine automobile des années 70 à 90. Mais ces deux ouvrages ont un point commun : ils donnent la parole aux opprimés et aux exploités, en l’occurrence les Roms et les ouvriers à la chaîne. Ces livres montrent surtout que la classe prolétarienne n’est pas homogène, elle est traversée par des antagonismes et des rapports de force parfois très virulents. « Roms et riverains » aborde ces antagonismes sous l’angle de la xénophobie et du racisme tandis que « Grain de sable sous le capot » se focalise surtout sur les différences culturelles entre les ouvriers de base et les autres travailleurs de l’usine. Les deux ouvrages prouvent que les révolutionnaires ne doivent pas idéaliser la classe prolétarienne comme étant un « tout » homogène, qui serait mécaniquement animé d’une volonté commune de renverser le capitalisme. En effet, si tous les prolétaires font face au même exploiteur – le capital – ils ne subissent pas tous la même intensité dans l’exploitation. Certains doivent affronter des conditions de travail et/ou de vie nettement plus dégradées que d’autres en raison d’inégalités spécifiques (liées aux assignations de genre et de race, au capital culturel etc.). Cette situation est susceptible de créer des divergences tactiques et – plus problématique – des rapports de domination entre les prolétaires eux-mêmes. Il est donc primordial pour les révolutionnaires de prendre en compte cette « lutte des classes dans la lutte des classes » – dans les revendications comme dans les pratiques – sous peine de reproduire des rapports d’exploitation et d’oppression entre nous.
Quand la culture ouvrière est dénigrée…
Marcel Durand – auteur de « Grain de sable sous le capot » et Ouvrier Spécialisé à l’usine Peugeot de Sochaux – critique le mépris de classe de l’aristocratie ouvrière, de la gauche bien-pensante et de la bourgeoisie envers les couches sociales les plus modestes. Il décrit la vie au travail dans les années 70 avec ces collègues qui rendent supportable le quotidien à l’usine en s’aménageant des espaces de liberté. Il s’agit essentiellement de moments de camaraderie (blagues, jeux, coups à boire…). Ces irruptions de culture ouvrière pendant le temps de travail ne sont évidemment pas du goût de la hiérarchie de l’usine, elle est toutefois contrainte de les tolérer car les chefs seraient bien incapables de tenir la cadence imposée par la chaîne. Elles sont aussi sévèrement critiquées par les bureaucraties syndicales et les ouvriers plus qualifiés qui se plaignent de la « mauvaise image » des travailleurs qui en résulterait. Ce mépris de classe s’est développé plus largement dans les années 80 dans le sillage de l’offensive idéologique libérale et, surtout, elle a été abondamment reprise par la gauche bourgeoise. En témoignent les nombreux personnages de fiction se moquant du prolo de base (le beauf, les Deschiens, les Bidochon etc.). Loin d’être un simple sujet de rigolade, la dévalorisation de la culture ouvrière a un véritable objectif politique et économique pour le capitalisme. Sur les lieux de travail, les patrons utilisent ce dénigrement pour effacer la conscience de classe qui se retrouve noyée dans la très vague notion de « classe moyenne » (alors que les différences de salaires restent les mêmes). Chefs et ouvriers se retrouvent réunis main dans la main pour « gagner la bataille de la productivité », comprendre « pour restructurer les usines pas assez rentables ». Concrètement, le patron remplace les bleus de travail par des uniformes verts, le tutoiement entre les cadres et les ouvriers devient la norme, les ouvriers spécialisés doivent devenir « polyvalents », les primes individuelles deviennent des primes par équipe, les temps de pause sont réduits au maximum. Autant de détails qui, mis bout à bout, servent à implanter des nouvelles technologies, des méthodes d’organisation de la production et de management inspirées du Japon. Dans un contexte de grèves importantes, il s’agit de déposséder les ouvriers de leurs savoir-faire pour réduire au minimum leur pouvoir d’agir sur la production. Ce sera la porte ouverte vers le développement de la précarité et de la dégradation des conditions de travail qui caractérise le monde de l’entreprise d’aujourd’hui.
… et le racisme décomplexé
« Roms et riverains » explique que les antagonismes de classe sont noyés dans la notion tout aussi vague de « riverains ». La figure du « riverain » permet de gommer les inégalités territoriales : l’habitant d’une cité HLM devient, par la magie de la novlangue, l’égal des habitants des quartiers pavillonnaires aisés. Certes le livre montre que les voisins des campements de Roms peuvent se montrer agressifs envers ces pauvres, qui renvoient à la face des « riverains » la persistance d’une pauvreté extrême qu’ils pensaient reléguée aux oubliettes de l’histoire ou dans les pays du « tiers-monde » (« leur misère est vécue comme une provocation, une remise en cause de l’ordre établi »). Un racisme pur et dur n’hésite pas à s’exprimer, avec le soutien de nombreux élus et des médias. Les discours haineux – avec la négation des Roms en tant qu’humains – s’accompagnent d’actions violentes rappelant le lynchage des Noirs pendant la ségrégation. Mais le livre souligne aussi la présence de nombreux voisins immédiats qui se déclarent solidaires et qui n’hésitent pas à agir concrètement pour venir en aide aux Roms. Toutefois, ces voisins-là se voient refuser le qualificatif de « riverains » par les médias.
Le racisme contre les Roms vise en particulier le « nomadisme » de ces derniers, qui est interprété comme un refus de travailler – de s’intégrer dans le moule de la société capitaliste – au profit du vol ou de la mendicité. Mais ces discours racistes oublient que les déplacements incessants des Roms (qui sont trop souvent tous assimilés dans les médias aux « gens du voyage ») sont subis, à cause de la misère et les destructions de campements par la police. Il ne s’agit certainement pas d’un « nomadisme » choisi comme c’est le cas dans la bourgeoisie. Les Roms se déplacent en toute logique vers les régions où se concentrent le plus de richesses à l’échelle de la planète, en espérant y trouver des moyens de survivre. De la même façon, les ouvriers venaient de toute la France, de la Yougoslavie ou du Maghreb pour travailler à Sochaux où l’usine était réputée pour verser des salaires relativement élevés.
Ce racisme répond, comme le mépris de classe, à des objectifs politiques et économiques. Quand un maire centriste déclare à propos des Roms qu’ « Hitler n’en a pas tué assez » (ou quand Pierre Mauroy expliquait pendant les grandes grèves des ouvriers de l’automobile qu’ils étaient « manipulés par les islamistes ») il ne s’agit pas uniquement d’une stupidité affligeante. Le racisme permet de polariser – de diviser – la classe prolétarienne. Ceci en unissant les « riverains » de la « classe moyenne » contre ces boucs émissaires qui ont le double tort d’être pauvres et étrangers. Les soutiens des Roms sont désignés d’office comme étant forcément des « bobos », sous-entendu des intellectuels petit-bourgeois des centres-villes déconnectés des préoccupations de la « France d’en bas ». Cette manœuvre de la bourgeoisie cherche à s’attacher la docilité de la classe ouvrière en l’opposant au lumpenprolétariat, aux immigrés et à la petite bourgeoisie intellectuelle. Le racisme bête et méchant sert à dépolitiser les enjeux économiques, ce qui permet de mettre sous silence la question de l’exploitation. Au lieu de questionner les rapports de production capitalistes à l’origine de la situation actuelle, les politiciens bourgeois mettent en œuvre une gestion technique – au pire policière ou au mieux humanitaire – de la pauvreté et de l’immigration.
Des formes de résistances autonomes
Les deux livres présentent l’intérêt de détailler précisément les pratiques de résistances des ouvriers de l’automobile et des Roms. Elles prennent la forme d’initiatives de solidarité de base, d’entraide mutuelle et de luttes d’autodéfense qui s’organisent en dehors des organisations et des institutions habituelles (partis, syndicats, médias etc.). Le moindre capital économique – et surtout culturel – est compensé par l’animation de réseaux de proximité à l’échelle de l’usine ou du quartier. « Roms et riverains » détaille par exemple l’organisation d’actions par des voisins qui dénoncent la responsabilité des autorités municipales dans l’insalubrité des campements (un véritable mur de poubelles est construit le long d’une route pour revendiquer la mise en place d’un ramassage des poubelles du campement). « Grain de sable sous le capot » montre un groupe d’ouvriers qui conteste l’exploitation à l’usine par le refus de la « novlangue », la dérision ou le sabotage (« le jeu consiste à calculer le temps que mettra l’obstacle à bloquer la chaîne »).
Face à cette résistance, la répression est sans état d’âme. Dans le cas des Roms, ils sont poursuivis et sanctionnés pour des motifs (le manque d’hygiène ou la faible maîtrise de la langue française par exemple) dont les autorités sont les premiers responsables (en refusant d’assurer les services publics de distribution d’eau potable ou de scolarisation des enfants Roms). Les deux livres expliquent qu’une véritable autogestion de la répression se met en place dans le but de la rendre plus « acceptable ». Les Roms touchaient des primes pour quitter « volontairement » la France (mais ils revenaient souvent dans la foulée étant donnée la politique de ségrégation dont ils sont victimes en Roumanie ou en Hongrie). Dans « Grain de sable sous le capot », les ouvriers touchent des primes en échange de leur coopération avec l’encadrement et de « bonnes idées » permettant de supprimer des postes. Pour accélérer le mouvement, petits chefs, flics, mais aussi « riverains », pourrissent la vie au quotidien des Roms et des ouvriers pour les pousser à quitter le pays ou l’usine d’eux-mêmes.
Les formes de résistances décrites dans les deux livres montrent aussi des limites. Elles sont souvent restreintes à des actions défensives à des échelles locales ou corporatistes. Elles peuvent concourir à une parcellisation des luttes lorsqu’elles ne sont pas reliées politiquement aux luttes globales pour la prise du pouvoir, contre les États et contre le capitalisme. Il s’agit aussi de ne pas se tromper d’ennemis : si le voisin raciste ou le syndicaliste jaune sont des collabos, il n’en reste pas moins que les cibles principales doivent être l’État et le patronat.
D’autre part, la prise en compte de la lutte des classes dans la lutte des classes par les révolutionnaires ne doit pas excuser les comportements réactionnaires. L’important besoin de main d’œuvre dans les années 60 a entrainé l’embauche de nombreux immigrés et de femmes, qui ont été placés sur les postes les plus pénibles et les moins bien rémunérés. Avec les gains de productivité et les restructurations dans les années 80, la baisse des besoins en main d’œuvre a été synonyme de concurrence accrue entre les travailleurs. Cette concurrence s’est malheureusement traduite par une hausse du racisme et du sexisme au sein même du prolétariat. « Roms et riverains » cite ainsi des immigrés originaires du Maghreb qui tiennent des propos de haine à l’encontre des Roms. « Grain de sable sous le capot » montre les comportements misogynes, parfois à la limite de l’agression sexuelle, largement répandus dans l’ensemble de l’usine.
En conclusion, il semble indispensable d’être en capacité d’inscrire ces formes de résistances, telles que celles citées dans ces deux livres, dans une perspective de luttes révolutionnaires et internationalistes. Tout l’enjeu est de réussir ce défi sans remettre en cause l’autonomie des actes de résistances et des réseaux de solidarité. Les organisations politiques doivent admettre que des discours et des pratiques politiques peuvent se développer à côté d’elles. Le fait que les milieux révolutionnaires sont en France composés en grande partie d’hommes blancs qui ont fait des études doit nous interroger sur nos pratiques quotidiennes. Nous ne parviendrons pas à éliminer les oppressions héritées de la société capitaliste tant que celle-ci sera en place. Mais nous pouvons les atténuer et les prendre en considération en créant des contre-pouvoirs et en imaginant des formes d’organisation permettant de prendre en compte le plus possible les antagonismes existants dans la classe prolétarienne. Loin d’être une simple « discrimination positive », il s’agit de lever les obstacles qui rendent les luttes politiques trop difficilement accessibles. Cela suppose de développer de nombreuses pratiques : la formation des nouveaux militants et l’éducation populaire (l’un des objectifs de Table rase), aller à la rencontre des prolétaires là où ils se trouvent et aux horaires où ils sont disponibles, de tenir compte des contraintes de la vie quotidienne (en mettant en place une garderie pour les enfants ou en limitant la durée des réunions par exemple), de prendre le temps d’expliquer la signification des multiples sigles et le jargon que nous utilisons par réflexe, de cadrer les prises de parole en réunion etc. La création d’une commission « élargissement » au sein du collectif unitaire 69 – qui regroupe dans le Rhône les intermittents et travailleurs précaires en lutte contre la réforme de l’assurance chômage – est un exemple d’outil possible. Cette commission est composée de travailleurs précaires qui se chargent de créer des liens avec d’autres précaires et privés d’emploi dans les quartiers, devant les CAF ou les pôles emploi. La commission leur offre un espace où s’organiser de manière autonome tout en restant actifs au sein du collectif unitaire. Mais les mesures formelles et organisationnelles ne font pas tout. Le plus important reste d’accepter pleinement les pratiques et les attitudes qui ne rentrent pas dans le moule des rituels militants, de reconnaître qu’il est impossible de devenir un militant modèle du jour au lendemain.