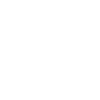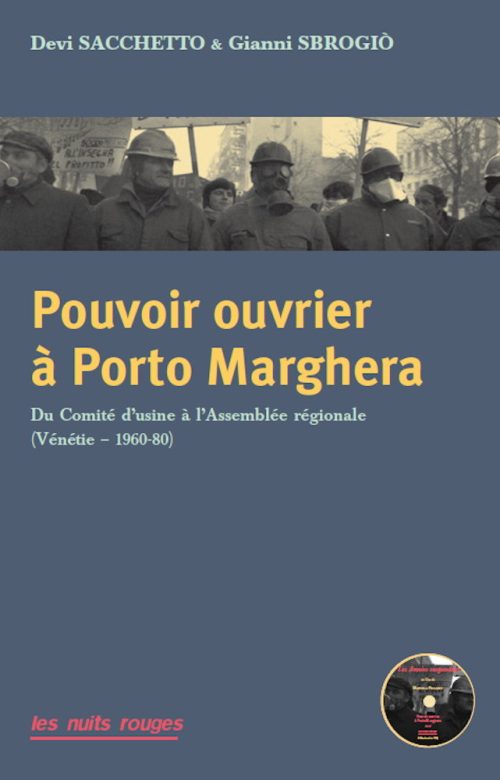Ce livre écrit par Gianni SBROGIO et Devi SACCHETTO a été accompagné par l’édition de deux autres bouquins sur les luttes à la FIAT de Turin et à la Magneti Marelli. La situation de Porto Marghera se distingue tout particulièrement par la prise en compte des enjeux environnementaux liés à l’industrie.
Gianni SBROGIO était technicien dans une entreprise mécanique de Marghera et il a été l’un des acteurs de l’autonomie ouvrière dans la région de Venise entre 1960 et 1980. Devi SACCHETTO est sociologue du travail. La première partie du livre est constitué par un long texte qui retrace les très nombreuses luttes à Porto Marghera (« banlieue » industrielle de Venise) qui ont animé cette période. Il est suivi par 4 autres textes plus théoriques et par une interview de militants qui ont participé à l’autonomie ouvrière. Il est accompagné par un documentaire sur DVD. La fiche de lecture va brièvement résumer et contextualiser le livre mais ne sera pas un compte-rendu exhaustif de celui-ci tant cet ouvrage fourmille d’informations.
L’autonomie ouvrière à l’assaut du ciel
L’autonomie ouvrière (également appelé « l’opéraïsme ») s’est développé dans un contexte d’industrialisation de l’Italie du Nord après la 2ème guerre mondiale, la Vénétie a notamment connue un gros besoin de main d’œuvre dans les années 50 et 60 qui a été comblée par le recrutement d’ouvriers-paysans peu qualifiés venant de la campagne alentour (à Turin ou Milan, ils venaient plutôt d’Italie du Sud). L’autonomie ouvrière est née de la rencontre entre ces ouvriers et des intellectuels marxistes au début des années 60. Elle s’est notamment focalisée contre le compromis de type « fordiste » existant à cette période. Ce compromis tacite, passé entre l’aristocratie ouvrière qualifiée (représentée par la démocratie chrétienne, le PCI ou la CGIL) et les classes dominantes, peut être résumé de manière schématique comme un échange « gagnant-gagnant » : l’octroi d’acquis sociaux en échange d’une relative paix sociale et d’une rationalisation du travail permettant d’accroître la productivité. Ce compromis supposait surtout le renoncement à la révolution et aux modes d’action situées hors de la légalité bourgeoise. L’autonomie ouvrière a attaqué frontalement cet état de fait en prônant le refus de la délégation et l’autonomie des luttes politiques. Elle a placée l’ « ouvrier collectif » au centre des luttes contre l’organisation capitaliste du travail. Elle a notamment beaucoup insisté sur la figure de l’ouvrier-masse (jeune, peu qualifié, polyvalent et souvent cantonné aux postes les plus pénibles et les plus dangereux) en opposition à l’ouvrier spécialisé (Cf le film d’Elio Petri, « la classe ouvrière va au paradis »). Elle a connue son sommet lors de la grève massive de la FIAT de Turin en 1969.
L’autonomie ouvrière a été théorisé, dans la revue « Quaderni rossi » dès 1961 et la revue « classe operaïa », par des intellectuels tels que PANZIERI, NEGRI ou TRONTI qui viennent de l’aile gauche du PSI et du PCI. Ces revues réclament un retour à Marx, en s’appuyant plus particulièrement sur le capital et le grundrisse. Toutefois, les positions théoriques et les choix stratégiques ne sont pas homogènes et varient selon les groupes et les auteurs. TRONTI va par exemple prôner l’entrisme au sein du PCI, tandis que d’autres vont plus se démarquer du marxisme orthodoxe en se référant au syndicalisme révolutionnaire ou au communisme de conseil (des conseils ouvriers ont été actif en Italie du Nord entre 1918 et 1920). Mais l’autonomie ouvrière a en commun la volonté de contrer les restructurations et les innovations du capitalisme en mobilisant les travailleurs directement concernés par ces nouvelles formes d’exploitation (les ouvriers-masse).
Des actions combatives
Le livre détaille un nombre très impressionnant de grèves et de blocages dans les sites industriels de Porto Marghera, notamment au « petrolchimico » (équivalent du site Kem One à Saint-Fons). Certains mouvements virent à l’émeute comme en avril 68 dans une usine textile de Voldagno. Les luttes concernent essentiellement jusqu’au début des années 70 les questions de hausse de salaire, de baisse des cadences et du temps de travail. Les plus grosses grèves ont lieu pendant l’été 1968 et à l’automne 1969, surnommé « l’automne chaud ». Elles auront un retentissement à l’échelle de toute l’Italie. Il y aura également des grèves contre la répression patronale et contre la dangerosité des installations industrielles, notamment au cours des années 70. Il faut également citer les nombreuses luttes contre la hausse des prix, pour le logement ou les transports gratuits.
L’outil principal utilisé par les « opéraïstes » est l’enquête ouvrière. Il s’agit d’associer les ouvriers à des enquêtes permettant d’analyser les ré-organisations en cours dans les usines, de dénoncer les conditions de travail ou encore de mieux connaître l’ennemi patronal et les évolutions du système capitaliste. Ces enquêtes sont réalisées en lien avec les habitants riverains des usines et avec l’aide d’étudiants politisés (par exemple des étudiants en médecine ont participé à une enquête sur les dangers sur la santé des ouvriers dans une usine chimique). Cet outil permet de mettre en avant des revendications correspondant aux besoins réels des ouvriers à la place des revendications dictées par les intérêts des appareils bureaucratiques. Il permet également d’évaluer les rapports de force et les possibilités de luttes.
Les actions dans les usines vont s’organiser dans le cadre d’assemblées générales dans les ateliers qui vont ensuite se regrouper dans une assemblée générale à l’échelle de l’usine toute entière. Ces assemblées court-circuitent ainsi les syndicats, qui sont vu comme des chambres d’enregistrement des revendications ouvrières définies par les assemblées générales, et ceci au grand désespoir des bureaucrates syndicaux. Lors des mouvements les plus importants, ce sont de véritables manifestations internes à l’usine qui déambulent dans les ateliers.
Le rôle du comité ouvrier d’usine
Sur Porto Marghera, l’autonomie ouvrière va se concrétiser autour de comités ouvriers qui prennent leur essor au début des années 60 sur des bases interprofessionnelles et qui sont influencés par PANZIERI. De tels comités seront actifs dans plusieurs sites industriels, principalement dans les secteurs de la chimie et de la métallurgie, où ils vont impulser de nombreuses luttes.
Le comité ouvrier du Petrolchimico va beaucoup insister sur la nécessité de détruire les rapports de production capitalistes, sur le refus du travail, sur la critique du salariat, de la technologie, de la hiérarchie. Ce comité va rejoindre le groupe « potere operaïo » qui a une audience nationale, avant de s’en éloigner en 72 (les autres organisations extra-parlementaires les plus importantes étaient « lotta continua » et « avanguardia operaïa » mais elle ne sont pas traitées dans le livre). Le comité ouvrier pense en effet que les comités ouvriers autonomes sont des espaces politiques suffisant pour mener le combat pour la révolution. Potere Operaïo va à l’inverse s’orienter vers des positions plus léninistes, mettant en avant la nécessité de construire un parti révolutionnaire centralisé pour prendre le pouvoir.
En 72 est crée l’assemblée autonome de Porto Marghera, qui rassemble des membres des comités ouvriers et des militants politiques locaux sur une base territoriale. Elle va éditée la revue « lavoro zéro » et créer une imprimerie militante.
Des revendications immédiates
De nombreuses revendications immédiates concernent les luttes dans l’industrie et sont issues des enquêtes ouvrières réalisées par les comités ouvriers. Parmi ces revendications, les plus importantes sont l’échelle mobile des hausses de salaires (c’est à dire des hausses de salaires tenant compte de l’inflation), la fin des divisions entre travailleurs des usines qui sont répartis par le patronat entre différentes catégories, la baisse des cadences.
Des revendications cherchent à articuler les luttes dans l’usine avec celles à l’extérieur, sous le mot d’ordre : « Usine, école, quartier, notre lutte est pour le pouvoir ! ». Les opéraïstes partent du principe que le coût de la reproduction de la force de travail doit être pris en charge par les capitalistes puisqu’ils sont les premiers bénéficiaires de l’exploitation des travailleurs. Les opéraïstes de Porto Marhgera seront donc à l’initiative de nombreuses luttes dans les quartiers qui vont prendre des formes d’actions directes : réquisitions de logements, non-paiements de factures d’électricité et de gaz, auto-réductions dans les magasins pour dénoncer la hausse des prix etc. La gratuité des transports est une revendication importante, les ouvriers venant de la campagne devant faire de longs trajets quotidien en bus pour se rendre à l’usine. Une revendication plus globale va être mise en avant : l’obtention d’un revenu garanti.
L’éclatement de l’autonomie ouvrière
A partir de 1973-1974, l’État Italien va planifier la création de nouvelles zones industrielles ailleurs en Italie afin de briser les luttes ouvrières en Italie du Nord (la France fera de même en industrialisant Fos sur Mer à la même époque au détriment du bassin Lorrain). Ce sera une aubaine pour les capitalistes locaux qui vont faire du chantage à l’emploi et à l’investissement.
Dans le même temps, le compromis de type fordiste est remis en cause par le capital lui-même. En effet, le capitalisme entre dans une nouvelle phase de restructuration afin d’enrayer la chute du taux de profit. Sur le terrain, ce changement se traduit par la réduction des investissements dans les équipements industriels, les délocalisations, des changements inspirés par le toyotisme dans l’organisation du travail, le développement de la sous-traitance et in fine le démantèlement des forteresses ouvrières. Les ouvriers font face à la dégradation de leurs conditions de travail et au développement de la précarité et de la flexibilité, ils vont passer de revendications offensives (hausse de salaire et baisse du temps de travail) à des revendications plus défensives (contre les fermetures d’usines). Cette situation va rendre les tensions avec les bureaucrates de plus en plus vives.
Les luttes contre les nuisances à Porto Marghera
La baisse des investissements dans l’industrie va entraîner une dégradation des conditions de sécurité dans les usines tels que le « petrolchimico » et être une source de nuisances et de risques majeurs pour l’environnement et les riverains (l’accident de Seveso date de 1976). La spécificité de Porto Marghera est la création d’ un comité de lutte contre la nocivité qui va notamment lancer une enquête ouvrière sur les dangers pour la santé. Le comité va aborder cette question en partant du principe que le meilleur moyen de réduire les risques pour la santé des ouvriers est de réduire le temps d’exposition aux produits dangereux, autrement dit lutter pour la réduction du temps de travail passé à l’usine. Il demande la fermeture des ateliers les plus dangereux et des investissements pour sécuriser les ateliers les moins nocifs, mais ces propositions provoquent l’hostilité des syndicats. En 1974, suite à une explosion dans un atelier, les ouvriers ne reprendrons le travail qu’après avoir obtenu la sécurisation des installations en cause. Il y a également des revendications visant à une réappropriation des connaissances scientifiques et de la technique par les ouvriers eux-même, dans le but de pouvoir établir un contrôle ouvrier de l’usine.
Les ouvriers se tournent vers d’autres formes de luttes
A partir du milieu des années 70, l’usine n’est plus le lieu central de l’activité militante pour une part non négligeable d’ouvriers, soit suite à un choix volontaire de quitter l’usine ou un licenciement, soit parce que les possibilités de luttes dans les usines deviennent plus difficiles (éclatement des collectifs de travail avec la mise place d’une organisation du travail inspirée par le toyotisme).
A Porto Marghera, l’Assemblée autonome va concentrer son action sur le thème du refus du travail et sur les luttes en lien avec les quartiers (logement notamment). Elle va publier en 1975 une brochure sur l‘absentéisme au travail comme mode d’action.
L’assemblée autonome s’auto-dissous en 1976 et se disloque en divers groupes autonomes. Des militants de l’assemblée autonome vont toutefois poursuivre la rédaction d’une revue baptisée « contro lavoro » qui sera publiée jusqu’en 1982 et qui restera fidèle aux positions défendues par l’autonomie ouvrière.
L’autonomie désirante
Une partie des militants vont se tourner vers des luttes plus sociétales et rejoindre le mouvement qui sera qualifié d’ « autonomie désirante ». Les revendications vont se focaliser sur l’émancipation des minorités et les luttes contre toutes les formes de domination. Il va notamment y avoir de nombreuses luttes pro-féministes. En 1974 par exemple, un combat important a lieu à Porto Marghera en faveur du « salaire domestique ». L’autonomie désirante va recourir à des modes d’action d’inspiration contre-culturelle et sur des bases affinitaires, plus éloignées des modes d’actions traditionnels utilisés par l’autonomie ouvrière, et se revendiquer du situationnisme ou des mouvements libertaires. Elle verra son apogée en 1977, avec notamment le mouvement étudiant de Bologne qui se soldera par l’intervention des chars de l’armée.
Glissement vers le réformisme pour certains…
Des ouvriers vont aussi se tourner (ou retourner) vers les organisations réformistes tels que le PCI, le PSI ou la CGIL. Le chantage à l’emploi et à l’investissement fonctionne auprès d’une partie de la classe ouvrière à cause de la peur du chômage. La répression policière et patronale va aussi pousser un certain nombre d’ouvriers à s’écarter et à se dissocier de l’autonomie.
Certaines organisations vont également chercher à s’institutionnaliser (Lotta continua par exemple) avant de disparaître. Des comités ouvriers vont quant à eux se tourner vers le syndicalisme alternatif (CUB, COBAS etc.).
Enfin, la récupération de revendications immédiates de l’autonomie ouvrière par les organisations réformistes expliquent aussi ce phénomène. Il faut souligner que certaines revendications étaient par certains côtés suffisamment ambiguës pour pouvoir être reprise par les réformistes. Par exemple, le revenu garanti est la porte ouverte à une réhabilitation de l’État providence ( http://www.tantquil.net/2015/05/05/revenu-garanti-salaire-social-un-tour-dhorizon-critique/ ).
… et vers le militarisme pour d’autres
Une autre partie des militants va s’orienter vers une tendance plus léniniste et plus militarisée. C’est notamment le cas de « Potere Operaïo » qui va chercher à se transformer en véritable parti politique marxiste-léniniste avant de disparaître en 1973. C’est aussi le cas de militants qui vont se tourner vers la lutte armée et assassiner des patrons et cadres dirigeants des usines. Ceci dans le contexte de la stratégie de la tension entretenue par l’Etat et l’extrême droite. A Porto Marghera, les brigades rouges vont tenter très maladroitement de faire de l’entrisme parmi les ouvriers du site industriel. En 1979, ce sera le prétexte à une véritable déferlante de répression qui s’abat sur les anciens militants opéraïstes les plus actifs (dont Gianni SBROGIO), avec la complicité des organisations réformistes. Certains militants passeront plusieurs années en prison, l’énergie des militants rescapés sera accaparée par l’anti-répression dans les années 80 et ils se verront de plus en plus isolés malgré la solidarité internationale venant notamment d’intellectuels français comme Foucault ou Deleuze.

Des apports pour les luttes actuelles
Des critiques adressées à l’opéraïsme
L’autonomie ouvrière a été critiqué car elle a été surtout théorisée par des intellectuels qui n’ont pas ou peu travaillé en usine, d’autant plus que certains sont devenus franchement réformistes (Cf le « néo-opéraïsme » de Negri par exemple). Ils ont ainsi pu être perçu comme des donneurs de leçon par les organisations déjà implantées dans les usines et par les syndicats, ou comme une avant-garde autoritaire par les anarchistes. Mais c’est aussi ce qui a fait la force du mouvement que d’être capable de mobiliser les connaissances des étudiants et des intellectuels aux côtés de celles des ouvriers pour pouvoir analyser l’évolution de l’organisation capitaliste. Avoir remis sur le devant de la scène la pratique de l’enquête ouvrière est un apport intéressant des opéraïstes qui pourraient inspirer les luttes actuelles.
À l’inverse, il a été reproché à l’autonomie ouvrière de défendre une approche classiste alors que la lutte des classes tendraient à disparaître selon certains.
Pourtant, l’industrie existe encore et reste la base de la production de marchandises dans la société capitaliste. En revanche, il est vrai que le secteur industriel, du fait principalement des innovations technologiques et des gains de productivité, a besoin d’une quantité beaucoup moins importante de main d’œuvre que dans les années 60 et 70. Ceci n’est pas sans poser quelques contradictions aux capitalistes pour qui l’exploitation des salariés reste la seule source de plus-value. Mais si l’industrie reste un enjeu crucial dans l’affrontement entre capital et travail, il faut reconnaître que le prolétariat ne se limite pas aux seuls ouvriers de ce secteur. Aujourd’hui, les prolétaires travaillent pour la plupart dans le tertiaire, dans des PME, voire même sont des travailleurs isolés (aide à la personne, nettoyage etc.). Cette situation rend difficilement reproductible les modes d’action de l’autonomie ouvrière qui sont donc à réinventer.
Des apports au niveau théorique
L’un des apports de l’autonomie ouvrière réside dans son attaque contre le capitalisme dans son ensemble, aussi bien contre le capitalisme industriel que le capitalisme financier (qui sont étroitement liés), contre l’économie capitaliste réelle que contre l’économie « virtuelle ». Il est salutaire de rappeler que le renversement du capitalisme ne pourra pas se dispenser de la destruction des rapports de production, et qu’il est donc dangereux de limiter sa critique au seul excès de la finance comme le font les réformistes d’aujourd’hui. Toutefois, les opéraïstes n’ont pas poussé la réflexion jusqu’à remettre en cause l’argent comme le font les communisateurs aujourd’hui.
Les opéraïstes ont également contribué à une réflexion intéressante sur la place de la technique et des innovations dans la société. Les théoriciens de l’autonomie ouvrière considèrent que la technique n’est pas neutre, que les innovations offrent des possibilités de réorganisation du travail et du capitalisme qui peuvent bénéfiques ou au contraire néfastes pour les ouvriers. Mais ils n’ont pas une position strictement anti-industrielle. Ainsi, ils ne cherchent pas à opposer les intérêts de classe des travailleurs aux préoccupations environnementales (comme le font les décroissants ou PMO aujourd’hui), au contraire ils cherchent à concilier les deux comme l’a montré l’expérience du comité contre la nocivité.
Les opéraïstes ont également été capable d’articuler les luttes dans les quartiers avec celles dans les usines. Il est vrai que la société était à l’époque plus politisé qu’aujourd’hui et qu’il y avait plus de relations entre le monde du travail et les territoires (vieil héritage du paternalisme). Mais l’autonomie ouvrière a eut le mérite d’initier des actions pour répondre aux besoins fondamentaux de la population dans une optique révolutionnaire tout en proposant des revendications immédiates (gratuité des services publics etc.).
Enfin, l’autonomie ouvrière n’était pas un bloc théorique monolithique et dogmatique. Ce mouvement a été traversé par des débats qui sont encore d’actualité. L’un de ces principaux débats est le rôle de l’organisation politique : les travailleurs organisés de manière autonome ont-ils la capacité de prendre le pouvoir en vue d’instaurer une société socialiste sans classe ni État ? Ou sont-ils condamnés à rester limités à des actions « para-syndicales» s’ils ne se dotent pas d’un parti ou d’une direction révolutionnaire ?