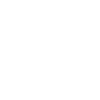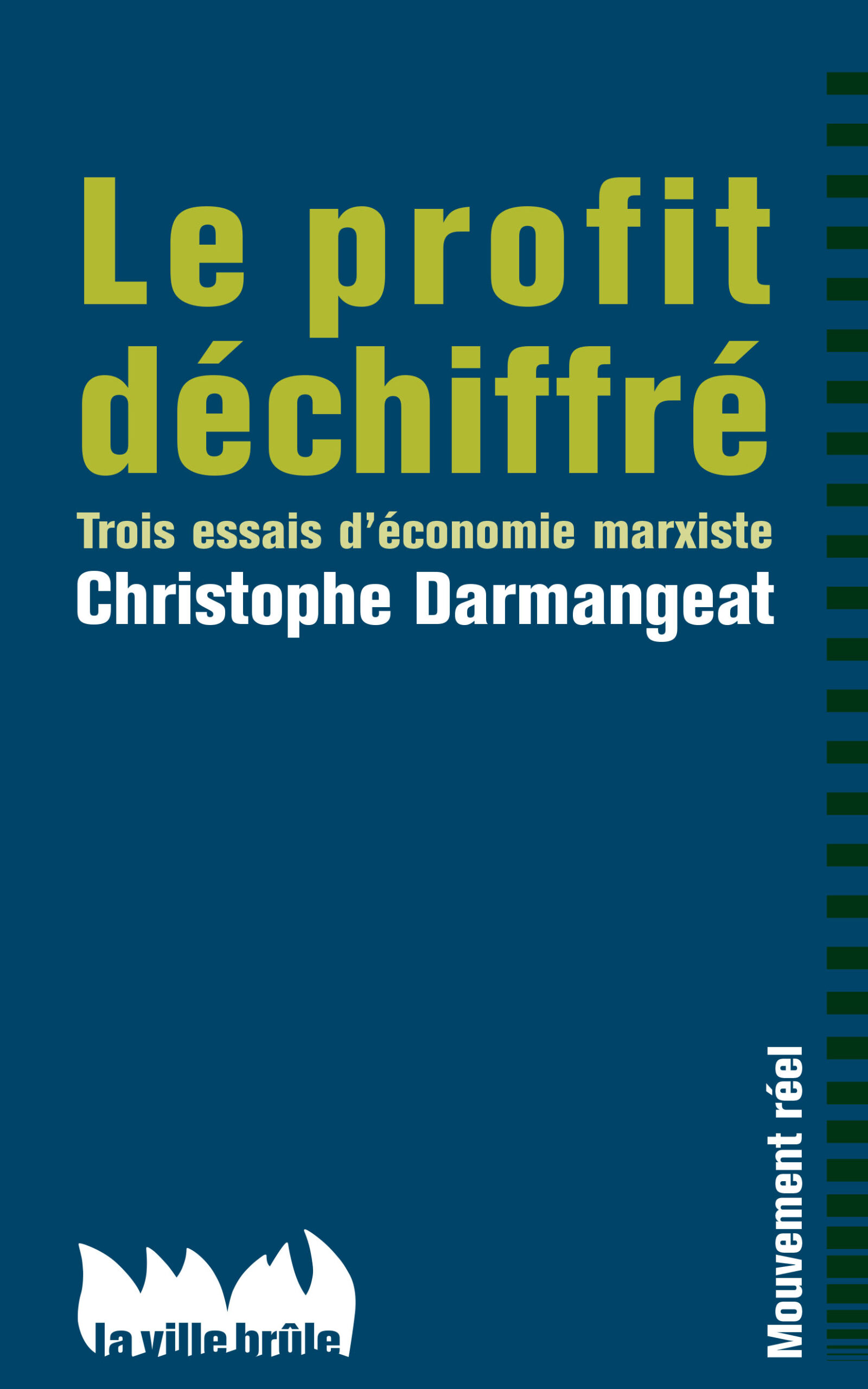Compte-rendu par un adhérent de la conférence de Christophe Darmangeat du 13/05/2017 autour du Profit Déchiffré. Christophe Darmangeat est enseignant chercheur à Paris 7. Cette conférence a lieu dans le cadre de son dernier livre « Le profit déchiffré » (éditions La Ville Brûle). La conférence est filmée et sera postée sur la chaîne Youtube de Table Rase.
Production dans la société capitaliste

La production, à la base, est un changement de qualité de matières premières (les ressources naturelles) vers un produit de meilleure qualité, par le biais d’un travail. Dans une économie capitaliste, la production est évaluée par la génération de profit, en considérant la valeur des ressources et du produit : on n’évalue plus le changement de qualité mais le changement de quantité de valeur pour définir la production. Celle-ci est alors définie par la consommation intermédiaire (les ressources et les travailleurs) mais aussi la valeur ajoutée. Cette dernière sert à générer des salaires et des profits : comme les salaires font partie de la consommation intermédiaire car c’est une part irréductible de la production, seul le profit est un résidu de cette production.
Explications classiques sur la nature du profit
- « On vend plus cher que ce qu’on achète » : oui en effet… ce n’est pas une explication mais une tautologie.
- « Le profit rémunère le risque pris par l’investisseur » : c’est un détournement de sens, le risque étant l’action des investisseurs sur ce qui pourrait ne pas rapporter de profits. Si un problème survient lors de la production, alors il n’y a pas de profit, mais la potentialité du problème ne génère aucune valeur.
- « Le profit rémunère l’abstinence, la renonciation à la consommation immédiate »: absurdité
Facteurs de production
Lorsqu’on remonte sur l’origine du capital, il est toujours dû à un travail passé.
Les facteurs de la production sont historiquement définis comme étant une terre, un capital et un travail.
Terre + Capital + Travail = Production
La théorie objective de la valeur travail revient sur ces 2 premiers facteurs. Le capital est en fait le fruit du travail passé. Lorsqu’on remonte sur l’origine du capital, il est toujours dû à un travail passé.
La terre n’est en fait pas importante dans cette équation : ce n’est qu’un support pour la production. Ce n’est pas parce que le travail a lieu sur une terre que cette terre est directement liée à la production (voir David Ricardo). Si on se place sur une terre avec un fusil pour taxer les passants, il y a transfert de valeur mais la terre n’en produit aucune en tant que telle. C’est la propriété sur la terre qui va générer une valeur pour le propriétaire.
Conclusions à tirer de la théorie objective de la valeur travail :
- La valeur c’est du travail
- Le capital ne fait que transmettre sa valeur
- Le travail ajouté crée de la valeur ajoutée
Pourquoi est-ce que les salaires ne captent pas le profit ?
Si les facteurs de production sont réductibles au travail seul, pourquoi est-ce que la rémunération du travail ne comprend pas les profits, la valeur résiduelle de la production ? Les salaires ne payent pas directement le travail effectué par les travailleurs, mais la capacité des travailleurs à travailler, i.e. celle de rester tel nombre d’heures activement au travail. On paye notre capacité à travailler alors qu’on travaille plus que ce dont on a besoin. Cette différence, au profit du patron, est nommée plus-value (ce qui est mauvaise traduction française).
Conclusions à tirer sur le profit :
- Exploitation du travail salarié : c’est l’appropriation gratuite d’une partie du travail.
- Exploitation sans contrainte extra-économique : la faim suffit à pousser les travailleurs à être exploités.
- Exploitation cachée par la forme du salaire, ou « prix du travail ».
- Les salaires sont régis par un rapport de forces sociales : seule la lutte des classes permet de définir les salaires : les travailleurs tentent de maintenir une rémunération la plus juste, les bourgeois tentent de la réduire au maximum.
- On ne peut mettre fin à cette exploitation qu’en abolissant le salariat, donc en supprimant la propriété privée des moyens de production.
Poussée à fond, cette théorie objective montre donc que le modèle d’économie capitaliste, la génération du profit, est basé sur l’exploitation des travailleurs.
La théorie subjective de la valeur
Les économistes bourgeois la rejette au profit de la théorie subjective de la valeur : si pour produire quelque chose j’ai besoin de terre, alors cette terre est utile et a donc de la valeur. De même, si mon capital à un instant T me permet de produire quelque chose, alors ce capital est utile. Le prix de chaque facteur de la production est alors en fonction de son utilité évaluée subjectivement. La rémunération tirée de ces facteurs est alors :
- La rente pour rémunérer la terre
- Le profit pour rémunérer le capital
- Le salaire pour rémunérer le travail
Conclusions tirées de la théorie subjective de la valeur :
- Le marché paye chaque facteur de production en fonction de sa valeur, créée par son utilité.
- L’exploitation n’existe pas : tout rémunération est juste car en fonction de l’utilité du facteur de production.
- Le marché capitaliste libre est donc la forme d’économie la plus juste, la plus efficace, etc.
Conclusions
La théorie de la valeur est un enjeu politique. Qu’elle soit objective ou subjective est un débat entre les économistes. On notera que ces économistes ne font pas tous de la science.
Les questions
Le rôle de l’argent au sein de l’économie capitaliste
L’argent ne change rien au fond de la théorie de la valeur travail car il ne fait que représenter cette valeur qu’est le travail. Changer de système monétaire peut permettre d’agir sur certaines parties de l’économie mais pas sur le fond.
Sur la valeur de la terre
Peut-on oublier la terre comme un facteur de production alors que celle-ci peut être plus utile si par exemple elle est défrichée, travaillée, construite, comparée à une terre vierge ? Oui car toute cette valeur de la terre est toujours issue d’un travail passé, au même titre que le capital.
L’écologie au sein d’une économie capitaliste
cette économie étant particulièrement difficile à réguler et gouverner, chaque patron voyant midi à sa porte, les décisions nationales (réformes) et internationales (COP, protocole de Kyoto) sur la protection de l’environnement sont impuissantes face au patronat du monde entier. Les préoccupations écologiques sont totalement incompatibles avec une économie basée sur le profit et seule une politique anticapitaliste permettra leur résolution : « Pour être vert, faut être rouge ! » [NDR : à ce sujet, je me permet de recommander les textes de Murray Bookchin sur l’écologie sociale].
Les actions à mener contre cette économie capitaliste
Pour commencer, la collectivité doit récupérer les moyens de production en abolissant la propriété privée. Lorsque les travailleurs seront capables de mettre en commun leur production, on pourra rendre gratuit de plus en plus de choses nécessaires à la vie quotidienne, tout en faisant évoluer les mentalités sur le travail et l’économie, et de fil en aiguille parvenir au communisme (c’est une piste).
Le revenu universel
En distinguant le revenu universel et le salaire à vie, le revenu universel est une mesure inutile et soutenue par la droite, à la rigueur capable de prévenir de l’extrême pauvreté mais sans garantie des conditions de vie correcte et laissant les patrons imposer des rémunérations toujours plus basses. Le salaire à vie quant à lui est une idée trop indirecte, car il n’est possible de toute façon qu’à condition de récupérer les moyens de production, donc autant se concentrer premièrement là-dessus.
L’état du capitalisme à l’échelle mondiale
Il ne s’effondre pas mais il « étouffe dans sa graisse » et a du mal à avancer. Une illustration comparant les investissements au taux de profit sur les dernières décennies montrent que les investissements étaient auparavant très liés au taux de profit, mais que depuis les années 70 le taux de profit continue d’augmenter alors que les investissements sont en chute. (pour l’illustration, voir Michel Husson, Un pur capitalisme).
Le retour nationaliste d’une partie de la gauche
La bourgeoisie mondiale n’a pas encore choisi le protectionnisme (e.g. le MEDEF qui demande à Le Pen de bien se calmer sur la sortie de l’euro). Les discours sur la souffrance des travailleurs qui serait liés à la politique (et aux travailleurs) des pays étrangers (coucou Mélenchon) sont un poison pour la lutte sociale qui devrait unir les travailleurs du monde entier, car une révolution sociale n’aboutira qu’à l’échelle internationale.